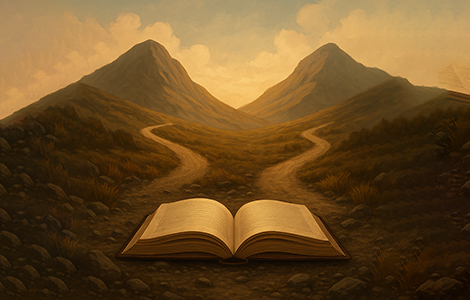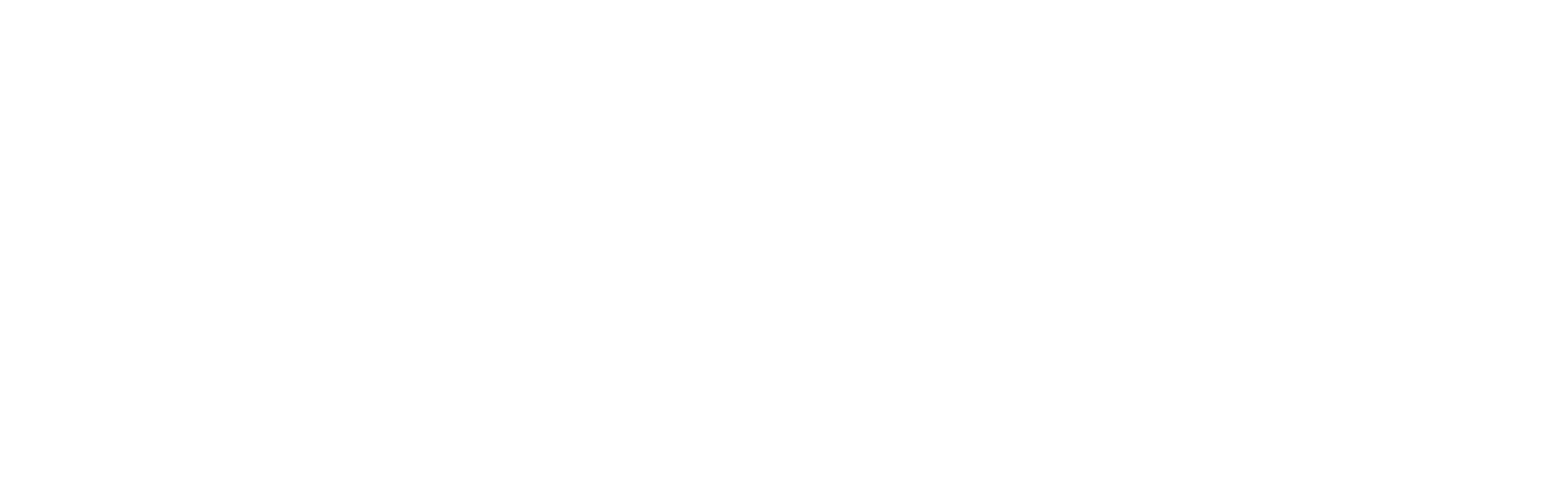Auteur : Markaz-e Pajuḥeshī-ye Ōlūm-e Islāmī-ye Nūr
Le Azādārī dans l’héritage prophétique et imāmite : Fondements scripturaires, pratiques et légitimité
Introduction
La question du Azādārī – ces cérémonies de deuil en mémoire de l’Imām al-Ḥusayn (as) et des martyrs de Karbalāʾ – suscite régulièrement des interrogations, tant au sein du monde musulman que dans les milieux académiques et médiatiques.
Pourquoi les chiites accordent-ils une telle importance à ces manifestations de deuil ? Quelle en est la signification, l’origine, et la portée spirituelle et sociale ?
Pour comprendre en profondeur cette pratique, il convient tout d’abord de clarifier un certain nombre de notions fondamentales liées à la mémoire du martyre, à la centralité de Karbalāʾ dans la pensée chiite, ainsi qu’au rôle que ces cérémonies ont joué – et continuent de jouer – dans la préservation des valeurs de justice, de résistance et de fidélité aux Ahl al-Bayt (as).
Différence entre le deuil personnel et le Azādārī
Dans l’approche chiite du deuil, il est essentiel de distinguer deux dimensions souvent confondues : le deuil personnel et les cérémonies collectives connues sous le nom de Azādārī.
Le deuil personnel est une expérience intérieure, spontanée et parfois déstabilisante. Il s’agit d’une réaction émotionnelle naturelle face à la perte d’un être cher, marquée par un repli sur soi, une douleur intime, et parfois un éloignement temporaire du quotidien.
En revanche, le Azādārī dépasse cette dimension individuelle. C’est une pratique consciente, collective et ritualisée, intégrée dans la structure sociale. Organisée autour d’un cadre codifié, elle s’inscrit dans un objectif plus large : non seulement consoler les cœurs, mais aussi transmettre une mémoire, renforcer la cohésion des croyants et raviver les valeurs spirituelles incarnées par les Ahl al-Bayt (as).
Dans les récits (riwāyāt) ainsi que dans d’autres sources historiques, plusieurs termes renvoient à l’idée de ce deuil rituel : ‘azā, mātam, nawḥa, tasallī, rithāʾ ou marthiyya. Nous commencerons par les explorer à travers leur usage courant et les définitions fournies par les dictionnaires.
1.1. ʿAzā : consolation, patience et épreuve face au deuil
Sur le plan linguistique, le mot ʿazā signifie patience et endurance face au deuil, bien qu’il puisse également désigner le chagrin et l’épreuve.[1]
Le verbe ʿazzā signifie quant à lui consoler, réconforter et exhorter à la patience, comme dans l’expression ʿazza ar-rajul, qui signifie consoler quelqu’un et l’encourager à faire preuve de patience.[2]
1.2. Tasallī : consolation et apaisement dans l’épreuve
Le terme tasallī désigne l’action de trouver un apaisement, de se calmer, ou encore de consoler une personne touchée par un deuil ou frappée par le malheur. [3]
1.3. Nawḥa : lamentation et expression du chagrin
Le terme nawḥa désigne l’action de pleurer, gémir et se lamenter à la suite d’un décès. Ainsi, dans l’expression : nāḥat al-marʾa ʿala al-mayyit nawḥan, on comprend que « une femme se lamenta sur le défunt ».[4] On emploie également le mot niyāḥa ainsi que nā’iḥa dans ce meme sens : il renvoie à un type de pleur accompagné de cris, de gémissements et d’agitation : une expression intense de la douleur.[5]
Le Dictionnaire Dehkhodā définit nawḥa comme « l’expression d’un malheur, pleurer à voix haute, lamentations, gémissements et cris, ou encore un chant funèbre, ou un poème récité dans le cadre du deuil avec une voix triste — que ce soit pour une personne récemment décédée ou pour les Imāms (as)[6] ».[7]
1.4. Mātam : rassemblement funèbre et expression collective du deuil
Le terme mātam, en arabe, désigne à l’origine tout type de rassemblement – qu’il s’agisse d’un événement joyeux ou triste – réunissant des hommes ou des femmes. Toutefois, avec le temps et dans l’usage courant, ce mot a pris un sens plus restreint, en venant désigner plus spécifiquement les assemblées liées au deuil, et en particulier les réunions féminines tenues à l’occasion d’un décès.
Ibn Manẓūr écrit à ce sujet : « Al-māʾtam, à l’origine, désigne une assemblée d’hommes ou de femmes dans un moment de peine ou de joie. Puis, par usage, il a été spécifiquement employé pour désigner les rassemblements féminins à l’occasion d’un décès… Dans la langue populaire, le mot renvoie à l’affliction : ils disent kunnā fī māʾtam fulān (“nous étions au rassemblement funèbre d’untel”) … »[8]
Fayūmī précise : « Al-māʾtam désigne tout rassemblement de personnes, de manière générale, mais le terme s’est progressivement spécialisé pour désigner un rassemblement marqué par la tristesse ».[9]
Autrement dit, si le mātam renvoyait à l’origine à tout type de réunion, son usage s’est peu à peu restreint pour désigner essentiellement les assemblées empreintes de deuil et de douleur.
Par conséquent, le mātam en est venu à signifier : deuil, affliction et cérémonie funèbre. Organiser un mātam, c’est mettre en place une cérémonie de deuil, pleurer un défunt et s’asseoir pour vivre collectivement le chagrin.
Dans la tradition islamique, cette pratique largement reconnue et répandue comprend plusieurs aspects : la commémoration du défunt, l’accompagnement des proches, ainsi que la prise en charge des personnes endeuillées — notamment par la distribution de nourriture.[10] Dans certaines cultures chiites, le terme mātam peut également désigner une forme de deuil collectif, consistant à se frapper la poitrine en signe d’affliction profonde.[11]
1.5. Rithāʾ : élégie, éloge funèbre et expression poétique du deuil
Le terme rithāʾ désigne l’acte de pleurer un défunt, d’énumérer ses qualités et de composer des poèmes en son honneur, exprimant douleur, compassion et respect.
Les lexicographes précisent : « Al-rithāʾ, al-marthiyya : élégie, forme de lamentation pour le défunt, poème funèbre et toute autre expression de deuil ».[12]
En d’autres termes, marthiyya renvoie à l’expression d’une bienveillance empreinte de tristesse : pleurer le défunt, louer ses qualités, et évoquer sa mémoire — en vers ou en prose. Par extension, marthiyya est défini comme : « un éloge funèbre, une cérémonie de deuil, une élégie, ou un récit douloureux (rawḍa) organisé en mémoire des martyrs de l’Islam — notamment durant le mois de Muḥarram, et particulièrement autour de la tragédie de Karbalāʾ ».[13]
2. Objections des opposants au Azādārī
Après avoir clarifié les principales notions liées aux pratiques du deuil rituel – tant sur le plan linguistique que socioculturel –, il est désormais nécessaire d’aborder un aspect fondamental : les critiques formulées à l’encontre du Azādārī.
En effet, malgré sa profondeur spirituelle et sa fonction mémorielle reconnue dans la tradition chiite, cette pratique fait l’objet d’objections récurrentes, tant dans certains cercles religieux que dans les discours modernistes.
Ceux qui s’opposent aux cérémonies de deuil avancent généralement plusieurs arguments, dont certains sont mentionnés ci-dessous :
- Aucune preuve issue de textes religieux ne valide cette pratique, ce qui en ferait une innovation (bidʿa).
- Le deuil serait une opposition au décret divin (qaḍāʾ wa qadar), suggérant que l’on refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, alors que le Coran dit :
ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۭ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ
« Ceux qui, lorsqu’un malheur les frappe, disent : ‘Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons.’ »[14]
- Quel est l’intérêt de commémorer des personnes qui ont été martyrisées il y a des siècles et qui ont déjà atteint un rang élevé auprès de Dieu ?
3. Arguments en faveur du Azādārī et réponse aux objections
3.1. Réfutation de l’accusation d’innovation (bidʿa) dans le Azādārī
Parmi les objections les plus répandues contre les cérémonies de deuil (Azādārī), celle qui revient le plus souvent est l’accusation d’innovation (bidʿa). Cette critique, principalement inspirée des thèses d’Ibn Taymiyya[15], affirme que cette pratique ne trouve aucune légitimité dans les textes religieux.
Bien que de nombreux ouvrages spécialisés aient déjà répondu en détail à cette allégation[16], nous présenterons ici quelques éléments essentiels permettant de comprendre en quoi cette critique est infondée.
A. Le deuil, une disposition innée (fiṭrī)
Pleurer, comme rire, fait partie intégrante de la nature humaine. Ces deux expressions extérieures sont le reflet de nos états intérieurs, qu’ils soient émotionnels ou spirituels.
La fiṭra — la disposition naturelle de l’être humain — est telle que la perte d’un être cher suscite la tristesse, tandis que l’acquisition d’un bienfait provoque le contentement.[17]
Ainsi, les larmes et les sourires jaillissent spontanément en réponse à la douleur ou à la joie.
L’Islam, en parfaite harmonie avec cette nature originelle, reconnaît et valide ces élans du cœur. Le Saint Coran affirme :
فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا
«Telle est la nature innée qu’Allah a originellement donnée aux hommes.»[18]
Les enseignements prophétiques abondent également dans ce sens. Le Saint Prophète (saw) et ses compagnons n’ont jamais réprimé leur peine. Au contraire, ils pleuraient sincèrement leurs proches disparus.[19]
B. Ce que l’Islam autorise au-delà des textes explicites
Par ailleurs, en droit islamique, ce qui est permis ne se limite pas uniquement à ce qui est textuellement mentionné dans le Coran ou les hadiths. Les savants distinguent généralement deux types d’actes licites :
- Les pratiques explicitement établies dans les textes, comme les deux fêtes de l’Aïd (Eid al-Aḍḥā et Eid al-Fiṭr).
- Les pratiques permises par principe général, dont la forme ou le cadre est laissé à l’initiative des croyants, selon les besoins et les contextes.
Par exemple, l’Islam ordonne d’éduquer les enfants, mais il ne fixe pas forcément un mode d’enseignement précis et unique, laissant ainsi cette responsabilité aux croyants. Par conséquent, il est évident qu’utiliser des moyens modernes comme l’ordinateur pour l’enseignement des enfants ne constitue pas une innovation religieuse.
De même, après le décès du Prophète (saw), ses compagnons ont rassemblé les différentes copies du Coran et ont diffusé un texte unifié, un événement connu sous le nom de tawḥīd al-maṣāḥif dans l’histoire islamique.
Pourtant, personne ne les a accusés d’avoir introduit une innovation, car ils considéraient leur action comme une application du verset :
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون
« En vérité, c’est Nous qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous qui en assurons la préservation. »[20]
Ainsi, bien que la compilation unifiée du Coran ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le texte sacré, son principe y est affirmé de manière générale.
De la même manière, organiser des commémorations – tant qu’elles respectent les limites de la loi islamique, est considéré comme une mise en œuvre d’enseignements religieux fondamentaux : honorer les figures sacrées, rappeler les injustices historiques, et renforcer les principes spirituels.
C. L’hommage légitime aux figures de l’Islam
Plusieurs versets coraniques ordonnent aux croyants d’honorer le Saint Prophète (saw),[21] sans limiter cet honneur à sa vie terrestre. Dès lors, organiser des rassemblements pour évoquer ses vertus ou rappeler les épreuves des Ahl al-Bayt (as) s’inscrit pleinement dans cet esprit, à condition bien sûr qu’aucun acte interdit n’y soit pratiqué.
Si nous, chiites, exprimons notre deuil et nos larmes à l’occasion des tragédies subies par les Imāms infaillibles (as), ce n’est ni un simple rite, ni un réflexe culturel : c’est l’expression sincère d’un amour enraciné dans notre être. Ces larmes sont un langage du cœur, une manière de manifester notre attachement aux figures saintes de l’Islam et, en réalité, de nous acquitter d’un droit fondamental :
قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ
Dis : « Je ne vous demande aucun salaire, si ce n’est l’affection envers les gens de ma proche parenté. »[22]
De nombreux savants sunnites reconnaissent explicitement que al-qurbā (« la proche parenté ») désigne Fāṭima (sa), ʿAlī (as) et leurs enfants.[23]
Dès lors, aimer les Ahl al-Bayt (as), se réjouir de leurs joies et souffrir de leurs épreuves, devient une obligation spirituelle pour tout musulman, en tout lieu et à toute époque.
Les cérémonies de Azādārī ont ainsi pour vocation de revivifier la mémoire des Imams (as), de dénoncer l’oppression, et de glorifier les symboles sacrés d’Allah (swt), conformément à de nombreux versets.
Ces versets se répartissent en plusieurs catégories :
- Les versets qui autorisent et ordonnent de dénoncer l’oppression et l’injustice.[24]
- Les versets qui confirment l’importance d’honorer et de glorifier les symboles sacrés d’Allah.[25]
- Les versets qui visent à renforcer l’autorité spirituelle et la wilāya.[26]
D. Un exemple coranique de deuil sincère : le cas du Prophète Yaʿqūb (as)
Le Coran lui-même témoigne de la légitimité du deuil et des pleurs sincères, à travers des récits de Prophètes. L’un des exemples les plus frappants est celui du Prophète Yaʿqūb (as), dont le chagrin face à la séparation avec son fils Yūsuf (as) fut si profond qu’il en perdit la vue :
وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ
وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ
« Que mon chagrin est grand pour Yūsuf ! »
Et ses yeux blanchirent d’affliction.
Et il était accablé.[27]
Selon le rapport de Zamakhsharī, le Prophète Yaʿqūb (as) pleura ainsi pendant soixante-dix ans, et ses pleurs furent si sincères qu’Allah lui accorda une récompense équivalente à celle de soixante-dix martyrs.
Tandis que les autres lui reprochaient :
تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ
« Par Allah ! Tu ne cesseras pas d’évoquer Yūsuf jusqu’à ce que tu t’épuises ou que tu sois parmi les morts ! »[28]
Le Prophète Yaʿqūb (as), exprimant la profondeur de sa peine, confia alors :
إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ
وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
« Je ne me plains qu’à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et, je sais de la part d’Allah, ce que vous ne savez pas. »[29]
Le Prophète Yūsuf (as), lui aussi, pleura dans l’épreuve, à tel point que les autres détenus, incommodés, lui demandèrent d’alterner les jours de lamentation et de silence. [30]
E. Une tradition établie dès l’époque du Saint Prophète (saw)
Par ailleurs, plusieurs récits attestent que le Noble Prophète lui-même (saw) pratiquait le deuil d’une manière ouverte, sincère et publique [31] :
- Lorsqu’il remarqua que toutes les familles de Médine pleuraient leurs martyrs tombés à Uḥud, alors que personne ne pleurait son oncle Ḥamza, il exprima sa tristesse.
Ses yeux se remplirent de larmes et il pleura en disant : « Pourquoi personne ne pleure pour Ḥamza ? » [32]
Touchées par sa douleur, les femmes médinoises vinrent alors se joindre à Fāṭima (sa) pour pleurer avec elle. Le Prophète (saw) leur dit alors :
« Qu’Allah (swt) vous fasse miséricorde ! Vous avez accompli le devoir de la compassion. »[33]
Ibn Masʿūd rapporte également à ce sujet :
« Le Saint Prophète (saw) pleura abondamment en deuil de Ḥamza.
Il orienta le corps de Ḥamza vers la qibla, se leva, pleura à haute voix et énuméra les qualités et vertus de Ḥamza ».[34]
- Le Saint Prophète (saw) pleura abondamment la mort de Jaʿfar également, et il ordonna :
« Que ceux qui pleurent, pleurent pour un homme comme Jaʿfar ! »[35]
Puis, il ordonna qu’un repas soit préparé pour sa famille, et recommanda de soutenir et réconforter les endeuillés — instituant ainsi une sunna.
Asmāʾ, l’épouse de Jaʿfar, rapporte : « Lorsque Jaʿfar fut martyrisé lors de la bataille de Muʾta, le Prophète (saw) vint chez nous et demanda :
« Où sont les enfants de Jaʿfar ? »
Je les lui amenai. Il les prit dans ses bras et se mit à pleurer… Ensuite, il ordonna qu’un repas soit préparé pour la famille de Jaʿfar et envoyé à leur domicile. Depuis ce jour, cette pratique est devenue une sunna ».[36]
Dans un autre récit, l’Imām al-Ṣādiq (as) rapporte :
Le Saint Prophète (saw) dit à sa fille Fāṭima (sa) de rester trois jours chez Asmāʾ et, durant ces trois jours, de veiller à préparer les repas pour la famille endeuillée de Jaʿfar.[37]
- Le Noble Prophète (saw) a versé des larmes à de nombreuses autres occasions, ce qui est consigné dans plusieurs sources historiques.
Par exemple : lors de la visite à Saʿd b. ʿUbāda, chef de la tribu des Khazraj, alors qu’il était à l’agonie ; ou encore lors du deuil de son fils Ibrāhīm ; ou à l’occasion du décès de ʿUthmān b. Maẓʿūn ; au cimetière de sa mère à Abwāʾ ; ou encore lorsqu’il évoquait le martyre de l’Imām ʿAlī (as). Il pleura également à maintes reprises le martyre de l’Imām Ḥusayn (as) dans divers lieux : chez Umm Salama, chez Zaynab, chez ʿĀisha, dans la maison de l’Imām ʿAlī (as), etc.[38]
- Il en est de même pour les compagnons du Prophète (saw) qui pleurèrent sa disparition. Parmi eux, Fāṭima al-Zahrāʾ (sa), Bilāl, Qays, Umm Ayman, etc.[39]
Ces récits démontrent clairement que le deuil (azā) et les pleurs face aux épreuves vécues par les élus d’Allah et les membres des Ahl al-Bayt (as) ne sont ni blâmés par le Saint Coran, ni réprimandés dans la tradition prophétique. Au contraire, ils relèvent d’une réaction humaine noble et reconnue, et d’une forme de proximité sincère avec la douleur des Prophètes et de leurs descendants.
F. Le deuil comme acte spirituel et protestataire
Le Saint Prophète (saw) n’a pas seulement pleuré ses proches ; ses larmes étaient l’expression sincère de la miséricorde du cœur. Mais dans le même temps, il transformait ces instants de deuil en leçons vivantes pour sa communauté : des moments où la douleur devenait rappel, éveil et affirmation des principes spirituels.
Dans cette lignée, Fāṭima al-Zahrāʾ (sa) pleura intensément la perte de son père, le Messager d’Allah (saw).
Chaque jour, elle prenait par la main ses deux fils al-Ḥasan et al-Ḥusayn (as), et se rendait à la porte de Médine. Là, à l’ombre d’un arbre, elle pleurait son père. Un jour, certains vinrent de nuit couper cet arbre. En réponse, l’Imām ʿAlī (as) lui construisit aussitôt un autre abri [pour qu’elle puisse continuer à exprimer son chagrin] [40]
Ces larmes, expression sincère de miséricorde et de deuil, étaient aussi le reflet d’une conscience éveillée, d’une douleur vécue comme un témoignage. L’expression de sa tristesse devenait un cri silencieux contre l’injustice : une manière de dire, sans discours, ce qui avait été usurpé, trahi ou renié. Ses pleurs suffisaient à révéler l’oppression subie. Et c’est cette sincérité — douloureuse, noble, lucide — qui donna à son deuil une force inaltérable dans la mémoire des croyants.
G. Le sens profond du Azādārī dans la tradition chiite
C’est dans cette continuité que s’inscrit le Azādārī chiite : non pas comme un simple rituel, mais comme un acte conscient de fidélité, de résistance et d’éveil spirituel. Pleurer al-Ḥusayn (as), ce n’est pas se détourner du décret divin — c’est manifester un rejet de l’oppression et proclamer son attachement à la vérité.
D’autres dimensions de cette pratique seront abordées dans la seconde partie de cet article. Pour l’heure, il est clair que l’accusation d’innovation portée contre le Azādārī repose sur une incompréhension des sources, une lecture littéraliste, et une ignorance des fondements juridiques et spirituels de cette tradition.
H. L’Imām al-Ḥusayn (as) et l’enseignement du deuil
Le jour de ʿĀshūrāʾ, alors que ses compagnons tombaient un à un, l’Imām al-Ḥusayn (as) pleurait leur perte et évoquait leurs qualités.
Il ne se contentait pas de ressentir la douleur : il l’enseignait, l’extériorisait. À sa fille Sakina (sa), il dicta des vers destinés à être récités plus tard par les chiites à Médine. Dans ces vers poignants, il liait à jamais la mémoire de Karbalāʾ à la conscience des générations futures :
شیعتی ما إن شربتم رِيّ عذب فاذكروني
« Ô mes chiites ! Chaque fois que vous buvez une eau fraîche, souvenez-vous de moi.
أو سمعتم بغريبٍ أو شهيدٍ فاندبوني
Et si vous entendez parler d’un étranger ou d’un martyr, pleurez-moi.
ليتكم في يوم عاشوراء جميعًا تنظروني
Ah ! Si seulement vous aviez été présents le jour de ʿĀshūrāʾ pour me voir,
كيفَ استسقيتُ لطفلي فأبَوا أن يرحموني
Comment j’ai imploré de l’eau pour mon enfant, mais ils ont refusé de me faire pitié.
وسقوهُ سهمَ بغيٍ عِوَضَ الماءِ المعيني
Ils lui ont offert une flèche injuste au lieu de l’eau pure.
يا لرزءٍ ومصابٍ هدّ أركانَ الحزوني
Ô quelle douleur ! Quelle épreuve qui a fait s’effondrer les piliers du deuil. »[41]
I. Les lamentations de Zaynab (sa), voix de la résistance
Après Karbalāʾ, la douleur ne s’est pas éteinte. Elle trouva sa voix dans les lamentations de Zaynab (sa), sœur de l’Imām al-Ḥusayn (as), portées avec dignité et fermeté.[42] À Kūfa, lorsqu’elle aperçut la tête de son frère, elle s’écria :
ما توهّمتُ يا شقيقَ فؤادي
كانَ هذا مُقَدَّرًا مَكتوبًا
« Ô toi, mon frère, moitié de mon cœur !
Jamais je n’aurais imaginé que le destin décrété s’accomplirait ainsi… »[43]
Par ces vers, elle faisait de son deuil un message : un acte de transmission et de dénonciation.
J. L’Imām Zayn al-ʿĀbidīn (as) : la mémoire à travers les larmes
Dans la mosquée des Omeyyades à Damas, l’Imām al-Sajjād (as) prononça également un sermon bouleversant, égrenant les titres de l’injustice :
أنا ابنُ المقتولِ ظُلمًا، أنا ابنُ المجزورِ الرأسِ من القَفا، أنا ابنُ العَطشانِ حتّى قضى… أنا ابنُ مَن رأسُهُ على السِنانِ يُهدى…
« Je suis le fils de celui qui a été injustement tué.
Je suis le fils de celui à qui l’on a tranché la tête par-derrière.
Je suis le fils de l’assoiffé, mort sans eau…
Je suis le fils de celui dont la tête fut brandie au bout d’une lance… »
Le rapporteur poursuit :
فلم يزل يقول: أنا، أنا، حتى ضجّ الناسُ بالبكاء
Il ne cessa de dire : « Je suis, je suis… », jusqu’à ce que l’assemblée éclate en sanglots.[44]
Il pleura tant pour Sayyid al-Shuhadāʾ (as) qu’il fut compté parmi les « bakkāʾūn »[45] – ces âmes marquées par une douleur profonde, dont les larmes incessantes témoignent de leur fidélité face à l’injustice.
Lorsqu’il voyait de l’eau, de la nourriture ou même un mouton égorgé, il rappelait la soif, la faim et l’égorgement de son père. Il disait :
لا تلوموني… فإنّ يعقوب فقد سبطًا من ولده فبكى حتّى ابيضّت عيناه من الحزن، ولم يعلم أنّه مات.
وقد نظرتُ إلى أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي يُذبحون في غداةٍ واحدة
« Ne me blâmez pas… Car Yaʿqūb (as) a perdu un seul fils et il a tant pleuré que ses yeux sont devenus blancs de tristesse, sans même savoir s’il était mort ou non.
Tandis que moi, j’ai vu de mes propres yeux quatorze membres de ma famille égorgés en une seule journée. »[46]
Et lorsqu’il s’asseyait à table, il disait :
قُتل ابنُ رسولِ اللهِ جائعًا، قُتل ابنُ رسولِ اللهِ عطشانًا
« Le fils du Messager d’Allah (saw) a été tué affamé,
le fils du Messager d’Allah (saw) a été tué assoiffé. »[47]
Et lorsqu’on lui apportait un récipient d’eau pour boire, il fondait en larmes. Quand on lui demandait la raison, il répondait :
كيف لا أبكي، وقد مُنِعَ أبي من الماء الذي هو مُطلقٌ للوحوشِ والسباع
« Comment ne pleurerais-je pas, alors que mon père a été privé de l’eau, cette même eau librement accessible aux bêtes sauvages et aux fauves ? »[48]
Et lorsqu’il voyait un boucher égorger un mouton, il disait :
« Avez-vous donné d’abord de l’eau à ce mouton ?
Mon père, lui, a été égorgé assoiffé. »[49]
Synthèse de la première partie
À travers l’examen des fondements linguistiques, historiques, scripturaires et spirituels du Azādārī, cette première partie de l’article a démontré que le deuil en mémoire de l’Imām al-Ḥusayn (as) et des Ahl al-Bayt (as) ne relève ni de l’innovation (bidʿa), ni d’une simple réaction émotionnelle. Il s’agit d’une tradition profondément enracinée dans l’exemple du Prophète (saw) et des Imāms infaillibles (as), répondant à un double objectif : préserver la mémoire spirituelle de Karbalāʾ et proclamer une fidélité active à la vérité, à la justice et à la résistance face à l’oppression.
Dans la seconde partie de cet article, nous approfondirons le rôle décisif joué par les Imāms al-Bāqir (as), al-Ṣādiq (as) et al-Riḍā (as) dans la structuration et la transmission de cette pratique, ainsi que les dimensions scripturaires, sociales et métaphysiques du Azādārī. Nous verrons comment ces cérémonies, bien au-delà de la commémoration, sont devenues un levier de guidance collective, un acte de foi incarné et une source d’éveil eschatologique pour les générations successives.
À suivre …
[1] Farhang ʿAmīd – définition du mot « ʿazā ».
[2] Al-Fayūmī, Miṣbāḥ al-munīr, p. 504.
[3] Farhang-i ʿAmīd, définition du mot « tasallī ».
[4] Al-Fayūmī, Miṣbāḥ al-munīr, p. 324.
[5] Maʿlūf, Louis (al-Lubnānī), al-Munjid, définition du mot « nāḥa ».
[6] NDT : Il est important de noter que les Imāms (as) eux-mêmes versaient des larmes pour le Maître des martyrs, l’Imām al-Ḥusayn (as), et recommandaient la récitation de lamentations (nawḥa). Des nawḥa furent également récitées en mémoire de Ḥamza (as), oncle du Prophète (saw), ainsi que pour bien d’autres figures éminentes – comme cela sera précisé dans les sections suivantes.
[7] Dehkhodā, ʿAlī Akbar, Lughat-nāma, définition de « nīāḥa » et « nāʾiḥa ».
[8] Ibn Manẓūr, Muḥammad b. Mukarram, Lisān al-ʿArab, vol. 12, p. 3 ; Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn, Majmaʿ al-baḥrayn, vol. 1, p. 29, définition du mot « mātam ».
[9] Miṣbāḥ al-munīr, p. 3.
[10] Muḥaddithī, Jawād, Farhang-i ʿĀshūrā, p. 395.
[11] NDT : cet aspect rituel du mātam fera l’objet d’un traitement spécifique dans un article ultérieur.
[12] Muḥaddithī, Jawād, Farhang-i ʿĀshūrā, p. 218.
[13] Dehkhodā, ʿAlī Akbar, Lughat-nāma, definition du mot « marthiyya ».
[14] Le Saint Coran, Sourate 2, verset 156.
[15] NDT : théologien du VIIe/VIIIe siècle de l’Hégire (XIIIe/XIVe siècle), connu pour sa lecture littéraliste des textes religieux et son hostilité déclarée envers de nombreuses pratiques liées au chiisme et au soufisme. Bien qu’il ait vécu plusieurs siècles avant le wahhabisme, ses écrits ont profondément influencé Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, fondateur de ce courant, qui s’est appuyé sur sa pensée pour rejeter nombre de pratiques traditionnelles islamiques, notamment les commémorations et les formes de vénération des Ahl al-Bayt (as).
[16] Āyatollāh Subḥānī, Buḥūth fī al-milal wa al-niḥal, pp. 91-103 et 318-330.
[17] Subḥānī, Jaʿfar, Buḥūth Qurʾāniyya fī al-tawḥīd wa al-shirk, p. 140, Muʾassasat Imām Ṣādiq (as), 1ʳᵉ éd., 1419.
[18] Le Saint Coran, Sourate 30, verset 30.
[19] al-Naysābūrī, Muslim b. Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 4, p. 1808, ḥadīth n°2315 ; al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn, vol. 3, p. 116.
[20] Le Saint Coran, Sourate 15, verset 9.
[21] Le Saint Coran, 7:157 ; 49:1-2 ; 24:63 ; 4:59, 4:80 ; 3:31 ; 9:24 ; 33:53, 33:56.
[22] Le Saint Coran, Sourate 42, verset 23.
[23] Fakhr al-Rāzī, Muḥammad b. ʿUmar, al-Tafsīr al-kabīr, vol. 27, p. 166 ; al-Haythamī, Nūr al-Dīn, Majmaʿ al-zawāʾid, vol. 7, p. 103 ; al-Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar, al-Kashshāf, vol. 4, p. 219
[24] Le Saint Coran, Sourate 4, verset 148.
[25] Le Saint Coran, Sourate 22, verset 32. Pour plus d’informations, voir Al-Ḥusayn min khilāl al-Qurʾān al-Karīm, écrit par Dr. ʿAbd ar-Rasūl al-Ghaffār.
[26] Le Saint Coran, Sourate 42, verset 23.
[27] Le Saint Coran, Sourate 12, verset 84.
[28] Le Saint Coran, Sourate 12, verset 85.
[29] Le Saint Coran, Sourate 12, verset 86.
[30] Majmaʿ al-bayān, Ṭabarṣī, vol. 5, pp. 235-257.
[31] NDT : Ce point sera développé plus en détail dans un article à venir, intitulé « La commémoration du deuil d’al-Ḥusayn (as) : une sunna prophétique ».
[32] Ibn Hishām, As-sīra an-nabawiyya, Beyrouth, Dār al-Qalam, vol. 3, pp. 104-105.
[33] Sīra al-Ḥalabiyya, vol. 2, p. 206 ; Maʿārif wa Maʿārif, vol. 6, p. 371 ; Biḥār al-anwār, vol. 82, p. 73 ; vol. 46, p. 215 ; vol. 22, p. 25 ; vol. 20, p. 98 ; Qiyām wa enqelāb-e Mahdī (ʿaj), p. 108 ; Dāstān-hā-ye Ustād, pp. 82–83.
[34] Sīra al-Ḥalabiyya, vol. 2, p. 60.
[35] Muḥammad b. Yaʿqūb, Tārīkh Yaʿqūbī, vol. 1, p. 427.
[36] Biḥār al-anwār, vol. 82, p. 83 ; Ṭabaqāt Ibn Saʿd, vol. 8, p. 282.
[37] Wasāʾil al-shīʿa, vol. 3, p. 236.
[38] Voir: Pāsokh be shobhāt-e ʿazādārī de Ḥusayn Rajabī, pp. 50–61, ainsi que Wafāʾ al-wafā, p. 468, qui affirme explicitement que le Prophète (saw) a pleuré pour l’Imām al-Ḥusayn (as). De même, la traduction de Nafas al-mahmūm, p. 34, rapporte : Lorsque l’Imām ʿAlī (as), au cours de la bataille de Ṣiffīn, passa par Karbalāʾ, il pleura intensément en évoquant le martyre à venir de l’Imām al-Ḥusayn (as). Et à la page 23 du même ouvrage, il est indiqué que lorsque Jibrīl révéla à Ādam (as) l’événement du martyre de l’Imām al-Ḥusayn (as), ce dernier pleura abondamment.
Voir aussi : Biḥār al-anwār, vol. 44, p. 293 : Le Prophète (saw) dit à Fāṭima (sa) :
« Tous les yeux seront en pleurs au Jour du Jugement, à l’exception de celui qui aura versé des larmes pour la tragédie de l’Imām al-Ḥusayn (as). »
[39] Ibid.
[40] Voir Bayt al-aḥzān, Shaykh ʿAbbās Qummī, p. 165 ; Biḥār al-anwār, vol. 43, p. 175–178.
[41] Mustadrak al-Wasāʾil, vol. 17, p. 26 ; Miṣbāḥ al-Kafʿamī, p. 741.
[42] NDT : Ce point sera développé plus en détail dans un article à venir, intitulé « La commémoration du deuil d’al-Ḥusayn (as) : une sunna prophétique ».
[43] Zaynab al-Kubrā, ʿAllāma al-Shaykh Jaʿfar al-Naqdī, p. 112.
[44] Al-Iḥtijāj, vol. 2, pp. 310–311.
[45] Al-Khiṣāl, p. 272; Wasāʾil al-shīʿa, vol. 2, p. 922.
[46] Amālī al-Ṣadūq, majlis 29, p. 121.
[47] Luhūf, Sayyid Ibn Ṭāwūs, p. 121/209.
[48] Manāqib Ibn Shahr Āshūb, vol. 2, p. 263.
[49] Maqtal al-Ḥusayn de Muqarram, p. 377.